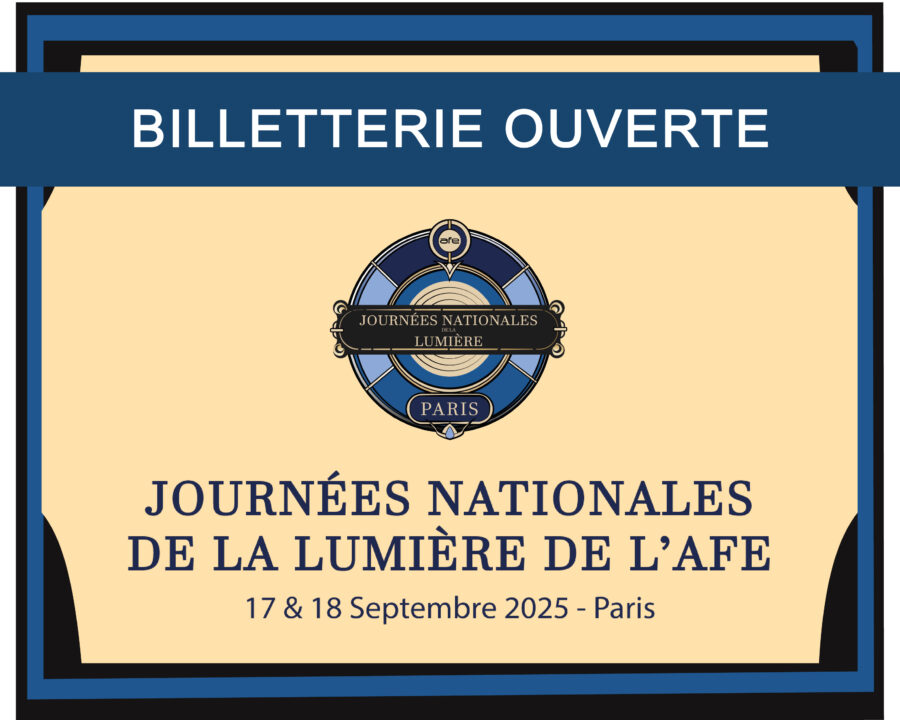Lumière et personnes âgées : les besoins lumineux
3 juillet 2018Luminance, une nouvelle référence ?
3 juillet 2018Villes durables et résilientes : qu’est ce qui est réaliste et qu’est ce qui ne l’est pas ?
En France, dès 2012, 66 % des communes de plus de 500 habitants réalisaient des investissements en matière d’éclairage public intelligent et 51 % en matière d’éclairage intelligent dans les bâtiments[1]. Si l’engouement est bien présent, pour les pôles urbains comme pour les pôles ruraux, plusieurs appels à la prise de recul ont été lancés. Des appels qui découlent des interrogations encore prégnantes quant à un certain effet gadget, au retour sur investissement et à un potentiel effet rebond de la consommation d’électricité. Alors que les obligations européennes et françaises enclenchent progressivement la marche vers la ville et le bâtiment durables, il semble urgent d’établir des critères de pertinence des investissements mais aussi la grille de compétences nécessaires. Une question d’autant plus importante en matière d’éclairage, qui joue sa place dans la chaine de valeur, mais qui semble tirer son épingle du jeu.
Priorités et conséquences des obligations légales
En matière de ville durable et intelligente, c’est la gestion des données qui mobilise le plus l’investissement des collectivités selon l’enquête « Territoires intelligents » menée par « La Gazette » et la Caisse des dépôts[2]. Rien d’étonnant à cela lorsque l’on connait les implications juridiques, financières et sociales rien que pour les obligations RGPD et open-data.
Un sens des priorités qui n’est toutefois pas défavorable à l’éclairage public, qui serait l’investissement le plus rentable de la ville durable selon une étude commandée par la Caisse des Dépôts et des territoires[3]. Alors que 59 % des collectivités auraient un projet d’éclairage public intelligent en cours de développement ou en projet de développement[4], 16 % auraient déjà franchi le pas. Un pari qui serait gagnant selon la Caisse des Dépôts et des territoires, avec le meilleur taux de rentabilité. A noter que le ROI tournerait autour de 11 années si l’on en croit l’exemple de Rillieux-La-Pape qui sert à l’analyse.
Enfin, 46 % des collectivités déclarent atteindre les bénéfices attendus en matière d’éclairage public (58 % pour les villes de moins de 20 000 habitants et 70 % pour les villes de plus de 20 000 habitants) selon une étude menée pour Syntec numérique[5].
Pourtant, plusieurs organismes ont appelé à la vigilance : l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), le Cerema, le groupe de travail du Plan Bâtiment Durable… autant d’acteurs qui ont émis des réserves sur la ville et le bâtiment durable, toutes en lien avec l’éclairage.
Des mises en garde contre les effets pervers
Trois principaux effets potentiellement pervers sont pointés du doigt :
- Le risque « gadget » et l’absence de raisonnement global : ne pas raisonner en usage seul (éclairage, sécurité) ou par la seule technologie utilisée
- Un effet rebond de la consommation d’électricité, lié à la consommation additionnelle des objets connectés et des centres de données
- L’explosion des DEEE, liée à l’obsolescence programmée
Des effets aux implications économiques et environnementales élevées.
Pour pallier ces écarts, un document commandé par le Cerema en 2018 préconise une stratégie des petits pas[6]. Une feuille de route à adapter également au budget, et pour laquelle l’éclairage ne serait pas étranger. Le principe est connu : dégager des économies via des investissements afin de pouvoir réinvestir sur la base des économies réalisées. Une stratégie qui ne peut s’envisager sans une attention particulière aux marchés publics.
« Les projets doivent correspondre à un réel besoin où la connectivité serait alors un atout majeur. Il convient, par exemple, de différencier l’apport des capteurs en tant que tels du simple changement de technologie (passage aux LED pour l’éclairage intelligent par exemple). C’est en ayant cette réflexion que l’efficacité sera réelle. »
Un raisonnement en global qui questionne le pilotage des projets et la collaboration entre services ainsi que de la souveraineté des territoires. Car près d’une collectivité sur dix préfère déléguer la gestion à une mission externalisée[7]. D’autre part, 30 % des collectivités n’ont pas de pilotage spécifique mis en place, fonctionnant au coup par coup.
Les nouvelles obligations liées à la ville, aux réseaux et aux bâtiments durables induiront inéluctablement une augmentation des coûts opérationnels, un renforcement des études d’ingénierie et le développement de nouvelles compétences pour les acteurs. Se posent également au quotidien les questions de la mutualisation des supports et des infrastructures, de l’évolution des appels d’offres, de la capacité de certaines collectivités territoriales à conserver une compétence éclairage public, et des modèles économiques pertinents des différents acteurs. Et l’échéance est courte : huit collectivités sur dix engagées dans la démarche ou en réflexion souhaitent terminer leur mue dans les dix prochaines années[8].
Alors que données et réseaux seront au cœur de la ville et du bâtiment durables, les besoins humains seront au cœur de leur construction. C’est pourquoi des collectivités viendront présenter leurs retours d’expérience sur le sujet : pertinence de l’investissement (IRVE…), conséquences organisationnelles et budgétaires, solutions de financement… Rendez-vous aux JNL2018 les 24 et 25 septembre 2018 ainsi que le 26 septembre 2018 pour la journée dédiée aux besoins humains, élément central de la construction d’une politique durable.
[1] ALECMM – 2016
[2] Enquête « Territoires intelligents » menée par « La Gazette » et la Caisse des dépôts - 2017
[3] Smart city : gadget ou création de valeur collective ? – novembre 2017
[4] Enquête « Territoires intelligents » menée par « La Gazette » et la Caisse des dépôts - 2017
[5] Enquête « Territoires intelligents » menée par « La Gazette » et la Caisse des dépôts - 2017
[6] La ville et l’internet des objets - Mettre l’Internet des Objets au service de la ville intelligente et durable
[7] Enquête « Territoires intelligents » menée par « La Gazette » et la Caisse des dépôts - 2017
[8] Enquête « Territoires intelligents » menée par « La Gazette » et la Caisse des dépôts - 2017
 Ajouter à mes documents favoris
Ajouter à mes documents favoris