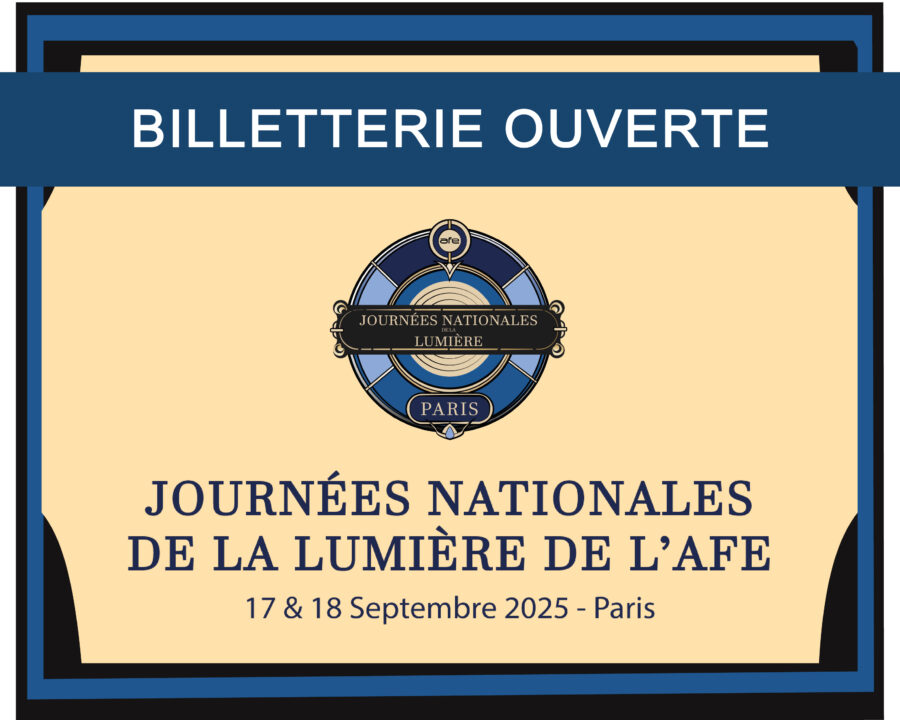Le Palais du Pharo – JNL2018
3 juillet 2018Villes durables et résilientes : qu’est ce qui est réaliste et qu’est ce qui ne l’est pas ?
3 juillet 2018Lumière et personnes âgées : les besoins lumineux
Cet article a été rédigé pour la revue Preuves & Pratiques (médecins généralistes) et est paru en 2018
1 personne sur 3 aura plus de 60 ans en 2035 selon l’INSEE, portant à près de 3 millions le nombre de déficients visuels. D’autre part, en 2016, les EHPAD accueillaient plus de 600 000 personnes en France, dont près de la moitié dans des structures publiques à la charge des collectivités[1]. Un chiffre qui devrait bondir puisque l’on devrait compter entre 1,7 et 2,2 millions de personnes âgées dépendantes d’ici 2040. Ces patients, qu’ils soient dépendants ou autonomes, ont une relation spécifique à la lumière et à la couleur, de par le vieillissement de leur système visuel.
Les dégénérescences et les déficits cognitifs liés à âge qui atteignent plus particulièrement la vision provoquent des handicaps progressifs qui influent sur la qualité de vie, la santé et l’autonomie des séniors. Ces personnes ne peuvent effectuer les tâches quotidiennes sans être aidées, notamment par un éclairage spécifique. En outre, chaque type d’atteinte de la vision engendre un rapport précis à la lumière, qu’il faut ainsi adapter à chaque espace et à chaque situation. La couleur joue, en complément de l’éclairage, également un rôle important, notamment pour apporter le contraste nécessaire.
Un document de l’Association française de l’éclairage, rédigé en collaboration avec des personnalités du domaine médical, propose un état des lieux des connaissances actuelles sur le sujet, permettant d’améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des personnes âgées. Cette approche permet de garantir la sécurité des patients, de participer à leur santé en régulant leur rythme biologique tout en participant à leur bien-être psychologique, réduisant ainsi les prises médicamenteuses. Des connaissances que les 11 millions d’aidants familiaux peuvent également appliquer pour les espaces domestiques ainsi que tous les professionnels de la santé traitant des patients de plus de 65 ans.
Les quatre fonctions essentielles de la lumière chez l’homme
Il est essentiel de rappeler que le système visuel humain, au-delà de permettre de voir, assure quatre fonctions au total, dont une partie est réservée à des fonctions non visuelles :
- une fonction motrice (orientation, détection d’obstacles…)
- Une fonction visuelle (lecture, reconnaissance des visages et objet…)
- une fonction cognitive (humeur…)
- une fonction de régulation de l’horloge biologique (sommeil…)
Ces fonctions dépendent de la capacité de l’œil à capter les signaux lumineux. Chez les personnes âgées, le vieillissement de l’œil et les pathologies qui y sont associées perturbent ces capacités (notamment la capacité à filtrer les émissions à haute intensité, telles que le bleu ou les UV, en sus de la diminution de la vision de près inéluctable à partir de 40 ans), induisant ainsi des effets sur les quatre fonctions simultanément.
Rappel
285 millions de personnes souffrent de déficience visuelle dans le monde selon l’Organisation mondiale de la santé. Personnes âgées et enfants sont particulièrement concernés. 65 % des personnes âgées présentent une déficience visuelle et 19 millions d’enfants sont concernés dans le monde. Des chiffres qui vont vite augmenter, puisqu’1 personne sur 3 aura plus de 60 ans en 2035 selon l’INSEE, portant à près de 3 millions le nombre de déficients visuels. A elle seule, la DMLA touche 8 % de la population française, et est la première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans.
Les différents besoins lumineux en fonction des pathologies
Deux grandes catégories de relation à la lumière se distinguent : les photophobes et les non photophobes. Pour chaque type d’atteinte, la relation avec la lumière est toutefois plus spécifique et nécessite des approches plus précises et personnelles.
Pour les atteintes centrales de la vision (DMLA…), les patients éprouvent des difficultés à lire et écrire mais aussi des difficultés de coordination visio-manuelle. En matière de lumière, cela s’exprime principalement par de la photophobie.
En ce qui concerne les atteintes mixtes, du type glaucome avec vision floue, les patients sont sensibles aux transitions lumineuses et ont du mal à s’adapter aux conditions peu éclairées. Ils éprouvent en effet des difficultés à reconnaitre des visages, effectuer des activités de détail, se déplacer…
Importance de la couleur
Principalement masculine, la déficience réelle de la couleur touche 8 % des hommes. La couleur est, après l’éclairage, le deuxième outil permettant de bien voir (voir ci-dessous pour la partie applications).
L’intérêt de l’approche lumineuse pour les professions médicales et le maintien à domicile
Derrière la relation lumière / personnes âgées se cachent trois grands enjeux :
- la sécurité /accessibilité, avec notamment la sécurisation du maintien à domicile ou des espaces des établissements de soins, en évitant le risque de chute, de confusion des objets…
- l’amélioration des échanges patients /soignants
- l’amélioration de la santé et du bien-être (approche psychologique), notamment en participant à la bonne régulation du sommeil.
Selon la Haute Autorité de la Santé, en France, près d'un tiers des personnes âgées de plus de 65 ans, soit près de 3,5 millions de personnes, et près de 40 % des plus de 85 ans consomment de façon régulière des somnifères. Plus de la moitié de ces traitements ne serait pas appropriés, les vraies insomnies étant rares chez la personne âgée[2].
Quel que soit le lieu, il est important de maintenir une exposition quotidienne, de préférence le matin, à la lumière naturelle. En contribuant à réguler le sommeil, une bonne hygiène lumineuse permet de diminuer les troubles du comportement chez les personnes dépendantes, une baisse du niveau d’anxiété ainsi qu’une amélioration de l’humeur et des capacités de concentration pour tous.
Applications à l’éclairage dans le domestique et les établissements de soins
Trois points doivent faire l’objet d’une attention particulière :
- la température de couleur de la source
- les lux
- la période de la journée
Dans le domestique, une veilleuse à température de couleur chaude est à maintenir au niveau du sol de nuit afin d’indiquer le parcours vers les toilettes et la salle de bain. Ces pièces doivent proposer, dans l’idéal, trois scénarios d’éclairage : diurne, crépusculaire et nocturne. De nuit, la température de couleur ne doit pas excéder 1 800 K. Le scénario nocturne, dérivé du scénario crépusculaire par la température de couleur chaude (1 800 K), doit en effet fournir une intensité lumineuse des plus basses, dans la limite de la distinction du cheminement et des équipements. Une main courante peut aussi être rétroéclairée le cas échéant.
Pour les escaliers, en matière de couleur et de revêtement, il est important d’éviter dans tous les cas les revêtements et peintures brillantes qui provoqueront des réflexions aléatoires difficiles à gérer pour les personnes atteintes de déficience visuelle.
De manière générale, la couleur, quant à elle, intervient pour les notions de contraste, notamment au niveau des portes et de l’espace déjeuner (contraste entre l’assiette et la nappe notamment).
Pour les locaux médicaux, la partie bureau doit maintenir 300 lux est à maintenir, avec une température de 5 000 K en journée (descendue à 3 000 K avant la pause déjeuner et en début de soirée, cette dernière variation devant s’étaler sur une trentaine de minutes). Un asservissement à la lumière naturelle est également conseillé. Les espaces d’examen doivent proposer un éclairage de 500 lux, avec la possibilité de régler le niveau pour les occupants.
Rendez-vous à la journée AFE / AsnaV du 26 septembre 2018 (offerte aux participants des JNL2018 - nombre de places limité) pour faire le point sur les besoins lumineux à chaque étape de la vie. Cliquez ici pour consulter le programme.
L’Association française de l’éclairage
Association à but non lucratif représentant la France dans les instances de normalisation nationales et internationales, l'Association française de l'éclairage (AFE) est une association dont les recommandations sont utilisées comme référence dans le Code du travail, les textes officiels et les appels d'offres. Ses adhérents, collectivités et professionnels, gèrent plus de 5 millions de points lumineux en éclairage public. Son pôle Collège Santé, composé d’experts internationaux et nationaux reconnus, effectue une veille sur les effets de la lumière sur l’homme. L’AFE réalise ainsi différents travaux sur la santé, dont des travaux sur la malvoyance (étude AFE 2017 réalisée avec la ville de Paris, Evesa et HandicapZéro).
www.afe-eclairage.fr
Recommandations de l’Association française de l’éclairage relatives à l’éclairage des lieux de soins et d’accompagnement – décembre 2017, parues chez Lux Editions. www.lux-editions.fr
[1] Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques - juillet 2017
[2] Troubles du sommeil : stop à la prescription systématique de somnifères chez les personnes âgées - 2012
 Ajouter à mes documents favoris
Ajouter à mes documents favoris