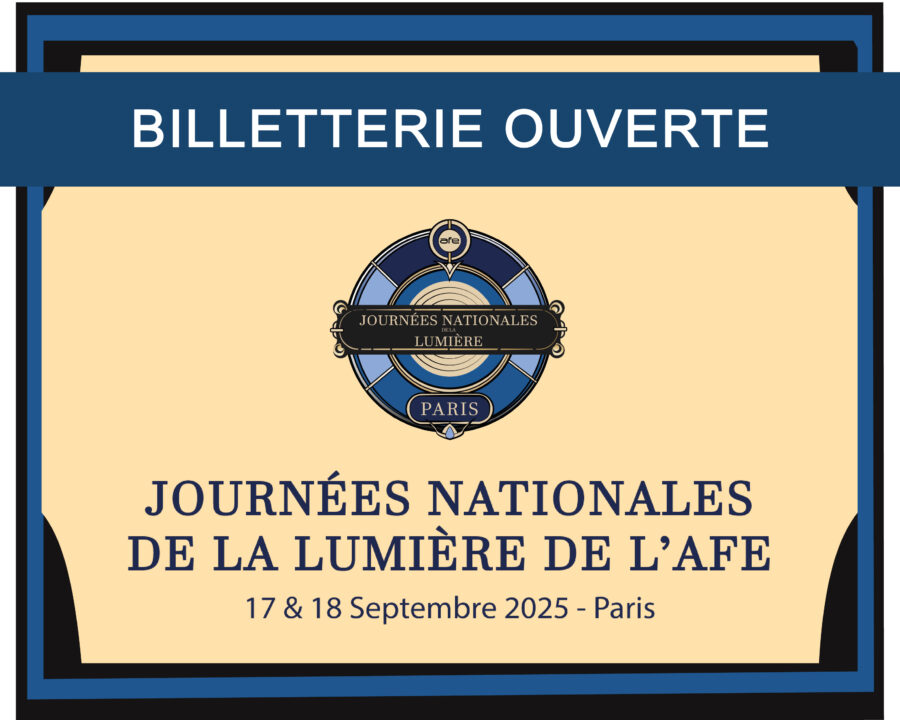Alain Maugard : quelle est la place de l’éclairage dans la rénovation des bâtiments en France ?
18 septembre 2018Ouverture de l’espace Business Center !
18 septembre 2018Modélisation et mesures de la pollution lumineuse : quelle(s) méthode(s) pour quel(s) résultat(s) ?
Comment mesurer la pollution lumineuse ? Avec quel(s) indicateur(s) et pour quelle(s) utilisation(s)? A l’heure où de nouvelles réponses doivent être trouvées (NDRL : le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) travaillerait actuellement sur un indicateur de pollution lumineuse), nous vous proposons, dans le cadre des 41e Journées nationales de la lumière de l’AFE, un focus sur les méthodes actuelles, en trois étapes :
- Un article destiné à expliquer la démarche de modélisation la plus aboutie à l’heure actuelle (note : cet article prend des valeurs hypothétiques à des fins illustratives - il ne peut donc être analysé en termes éclairagistes), rédigé par le bureau d’étude DarkSkyLab. Cette méthode de modélisation est par exemple utilisée dans la RICE (réserve internationale de ciel étoilé) du Pic du Midi et le Parc National des Pyrénées. Cliquez ici pour consulter l’article.
- Autre temps des JNL2018, la Ville de Paris présentera son retour d’expérience sur la cartographie aérienne nocturne réalisée en 2018. L’occasion de quantifier la domanialité public / privé des points chauds et de déterminer et quantifier l’origine de ces points sur l’espace public. Quelques surprises sont au rendez-vous.
- Enfin, pour rappel, deux méthodes coexistent aujourd’hui :
- La première utilise les images satellites de la NASA, soit la méthode de cartographie par imagerie satellite. C’est par exemple la méthode utilisée pour les études sur les effets de la lumière sur l’homme.
Elle présente quatre défauts principaux, liés à la mesure par la radiance :
- l’imagerie satellite ne capture pas la diffusion latérale à 100 km,
- les détecteurs, de par leur sensibilité, coupent à 500 nanomètres et sont donc incapables de mesurer efficacement le spectre dans le bleu,
- Les satellites passent généralement au-dessus de la France après 1h00 du matin. Il n’est donc pas possible d’obtenir les mesures en début de nuit avant les variations de puissance,
- Les mesures ne sont valables que par beau temps, les nuages étant capables de multiplier par 10 ou par 20 la pollution lumineuse.
L’Atlas mondial de la pollution lumineuse se base sur ces données, en alliant les données de la NASA et des données issues de la science participative (données SQM).
- Seconde méthode : la modélisation présentée dans l’article de DarkSkyLab. Elle intègre l’ensemble des données satellites, des données géo-référencées (SIG…) et terrain (occupation des sols…) afin de modéliser la formation du halo lumineux. Puis elle complète ces données par un modèle empirique de validation sur le terrain. Pour consulter l’article, cliquez ici.
Rendez-vous aux 41e Journées nationales de la lumière de l’AFE.
Programme
Inscription
Note : l’AFE travaille actuellement sur un indicateur de nuisances lumineuses. Plus d’informations à venir.
 Ajouter à mes documents favoris
Ajouter à mes documents favoris